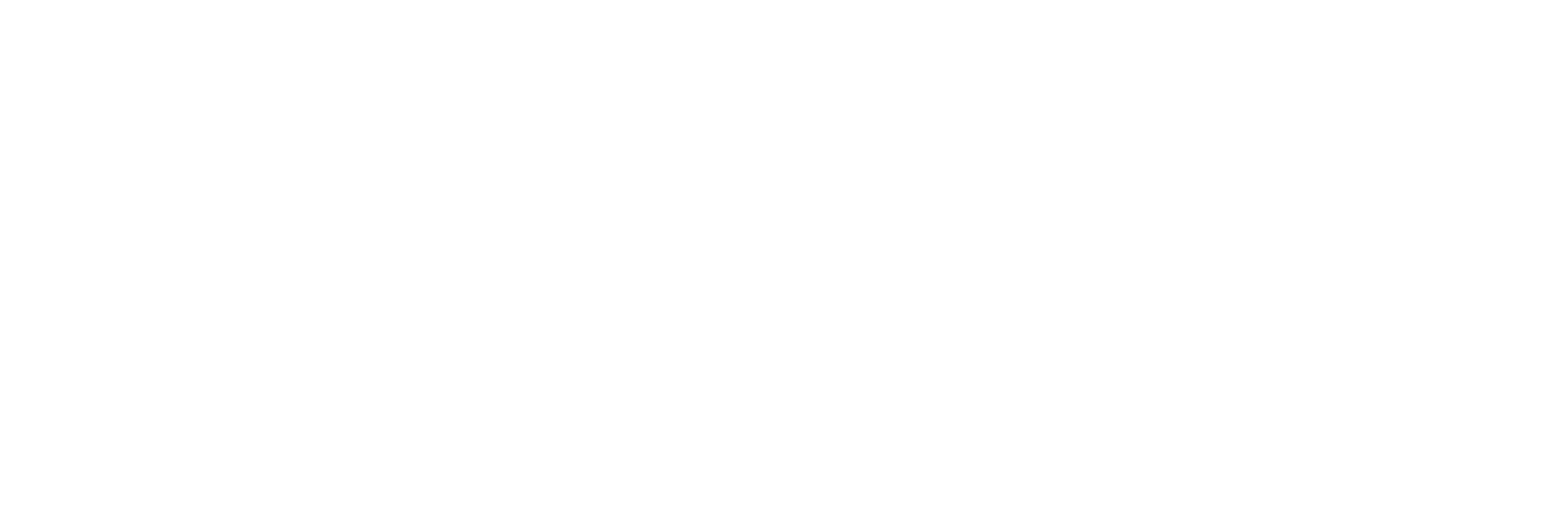Département de Chocó Chocó. Un employé du CICR parle aux membres du groupe armé ELN des principes du droit international humanitaire et de l'obligation de respecter la vie des civils. Crédit photo : CICR/Juan Arredondo
Les humanitaires opérant sur les lignes de front des conflits armés d'aujourd'hui doivent utiliser un ensemble de compétences combinant à la fois l'esprit et la tactique afin de surmonter la force et la suprématie territoriale de leurs contreparties groupes armés. Dans cet article, nous explorons les défis auxquels les humanitaires sont confrontés lorsqu'ils négocient avec des groupes armés non étatiques, les stratégies dont ils disposent et la manière dont elles sont liées à la pratique de la diplomatie humanitaire.
La diplomatie humanitaire est souvent considérée comme faisant partie de l'action humanitaire et elle englobe le domaine toujours plus vaste de la négociation humanitaire. Il existe une symbiose étroite : la diplomatie humanitaire ne peut pas vraiment être séparée de la négociation humanitaire , car elle risque de perdre tout son sens si elle n'est pas proche des réalités opérationnelles. De même, la négociation humanitaire sans la diplomatie humanitaire n'aura qu'un impact limité et la qualité des accords négociés risque d'être médiocre.
Défis communs avec les groupes armés
Avant de discuter des solutions, nous devons d'abord discuter des défis. Ceux-ci découlent en partie de la complexité du système humanitaire mondial actuel, qui est fortement décentralisé et, malgré une tendance à la morphologie, est souvent régi par le consensus. En outre, ses fondements sur les principes humanitaires et le droit international humanitaire sont utilisés pour opérer dans des environnements où la même idéologie fait défaut, ce qui signifie que les humanitaires sont confrontés à une série de dilemmes pratiques et opérationnels.
La négociation de l'accès avec les groupes armés en est un exemple typique. Face aux groupes armés, les humanitaires négocient souvent en position de faiblesse. Les difficultés commencent souvent au sein même du secteur humanitaire ; sur le terrain, l'éventail des agences humanitaires est plus varié que jamais. Ces défis peuvent se manifester sous la forme de priorités opérationnelles dépendantes des acteurs, d'accords multipartites variables et même d'interprétations différentes de la nature de l'humanitarianism, entre autres. Cela crée un cadre complexe dans lequel les humanitaires doivent opérer. Il est difficile pour un individu de représenter la totalité d'une cause ou d'un système, et cette approche fragmentée ne peut qu'être un obstacle à une négociation efficace.
Lorsque l'on envisage des contreparties négociation, la question de savoir ce qui constitue un groupe armé et qui le constitue est importante dans différents contextes. Tous les groupes armés ne sont pas ouverts à la négociation et les humanitaires ne peuvent ou ne veulent souvent pas négocier avec les groupes terroristes, par exemple. Les contreparties négociation, telles que les groupes armés, reconnaissent ces approches dispersées et ces dynamiques complexes et peuvent les utiliser pour servir leurs propres intérêts. Les acteurs humanitaires peuvent être montés les uns contre les autres ou mis en concurrence dans un secteur donné. Même si le feu vert est donné, l'entreprise peut être torpillée à l'étape suivante en raison de difficultés pratiques d'accès ou parce que les risques et dangers potentiels sont trop importants.
Surmonter l'asymétrie de pouvoir
La bonne nouvelle, c'est que les humanitaires peuvent négocier l'accès et la fourniture de l'aide de manière plus efficace que ne le laissent supposer les probabilités qui pèsent sur eux. Malgré les difficultés susmentionnées, et parfois à cause d'elles, les humanitaires disposent d'un éventail de tactiques et de stratégies.
Le renforcement de la capacité à accord avec les groupes armés, au niveau individuel et institutionnel, s'est avéré efficace, tout comme des politiques et des recherches plus solides. Les capacités peuvent être renforcées par la formation, la cooperation avec différents acteurs humanitaires, l'exploitation des connaissances des membres du personnel local et expérimenté, l'établissement de relations et la répétition. L'instauration de la confiance est une activité importante pour les humanitaires afin de démontrer leur impartialité et leur neutralité. D'une manière générale, les humanitaires ne doivent pas minimiser leurs propres qualités non intimidantes, car c'est souvent là que commence le dialogue sur la confiance et l'établissement de relations.
Un autre outil essentiel est la prise de conscience du contexte. L'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir est de prendre en compte les intérêts des contreparties négociation. Les humanitaires doivent se demander quels sont les objectifs du groupe armé en question. Les objectifs d'un groupe armé peuvent inclure le maintien et l'augmentation de sa légitimité ou de sa réputation, ou la substitution d'un certain service qu'il fournit par quelque chose d'autre.
Il est important de noter que la force humanitaire réside parfois dans l'interconnexion de notre monde. La possibilité de s'asseoir à la table des négociations avec une organisation humanitaire internationale de premier plan peut donner à un groupe armé un sentiment de légitimité, qui peut être renforcé par la signature d'un cessez-le-feu ou d'un accord de paix. Le recours à des tiers, par exemple en faisant pression sur le Conseil de sécurité des Nations unies, est une autre option au niveau international. Les méthodologies alternatives sont une autre voie à explorer ; nous devrions nous demander ce qui peut être fait à distance (une conversation opportune compte tenu de la pandémie de COVID-19) ou par l'intermédiaire de partenaires locaux. Parfois, la question devrait porter sur ce qu'il ne faut pas faire - le retrait et la conditionnalité peuvent être des tactiques acceptables dans certain situations.
La diplomatie humanitaire : la praxis entre l'apolitique et le politique
En s'engageant dans des négociations avec des groupes armés, les humanitaires contribuent à définir l'agenda politique international, qu'ils soient d'accord ou non. Les négociations humanitaires sont au cœur des affaires mondiales - et non pas périphériques, comme on a pu le penser par le passé. Ces négociations sont intrinsèquement politiques : la diplomatie de première ligne se déroule sur la ligne de front des conflits en cours. Les humanitaires s'engagent à des niveaux sans précédent et façonnent la réalité politique dans laquelle opèrent d'autres acteurs, tels que les diplomates des États traditionnels et leurs intérêts respectifs en matière d'affaires étrangères et de sécurité.
C'est en naviguant dans cette arène politique humanitaire que la diplomatie humanitaire devient un instrument utile, utilisant des méthodes et des outils diplomatiques pour atteindre des objectifs humanitaires. La diplomatie humanitaire incarne le pragmatisme humanitaire et, le cas échéant, le compromis. Dans la diplomatie humanitaire, les principes humanitaires sont une carte routière mais pas la destination finale, comme l'affirme Ashley Clements[1]: "Ne pas faire un certain niveau de compromis éthique à travers la négociation risque de fétichiser les principes humanitaires au détriment de la satisfaction des besoins humanitaires. Ces principes, bien que fondamentaux, sont un moyen de parvenir à une fin et non une fin en soi".
Si les besoins humanitaires sont criants, il y a souvent une course contre la montre pour y répondre, mais les obstacles peuvent devenir de plus en plus difficiles à surmonter. Négliger la diplomatie humanitaire ou l'aborder de manière ad hoc peut limiter l'impact humanitaire. En intégrant la diplomatie humanitaire et ses pratiques dans le travail des praticiens de manière consciente et réfléchie par le biais de l'apprentissage, de la formation et de l'expertise, les humanitaires sont mieux équipés pour naviguer dans les réalités opérationnelles de manière durable. Lorsqu'il s'agit de trouver des solutions à des situations complexes, un élément essentiel de la diplomatie humanitaire consiste à impliquer toutes les parties prenantes officielles et non officielles dans le contexte humanitaire, y compris les groupes armés.
Cet article est le résultat d'un séminaire en présentiel et d'un webinaire, "The Front lines of Diplomacy : Négociations humanitaires avec les groupes armés", qui s'est tenu le 1er octobre 2020 à Bergen Global à Bergen, en Norvège. L'événement comprenait une présentation d'Ashley Jonathan Clements (consultant) et des commentaires de Marte Nilsen de l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo (PRIO) et de Salla Turunen de l'Institut Chr. Michelsen (CMI). Vous pouvez également visionner un enregistrement de l'événement.
[1] A.J. Clements, Humanitarian Negotiations with Armed Groups : The Front lines of Diplomacy, 1ère édition, Routledge, Londres et New York, 2020, p. 183.
A propos de l'auteur

Salla Turunen est chercheuse doctorante au CMI et au département de politique comparée de l'université de Bergen, en Norvège. Avec une expérience de praticienne à l'ONU, ses recherches portent sur l'articulation de la diplomatie humanitaire et des négociations dans les situations d'urgence complexes, dans le but d'informer les débats académiques et de contribuer au travail des professionnels de l'humanitaire. Ses travaux de recherche actuels à l'ONU font partie d'un projet de recherche intitulé "Humanitarian Diplomacy : Évaluation des politiques, des pratiques et de l'impact des nouvelles formes d'action humanitaire et de politique étrangère", financé par le Conseil norvégien de la recherche.