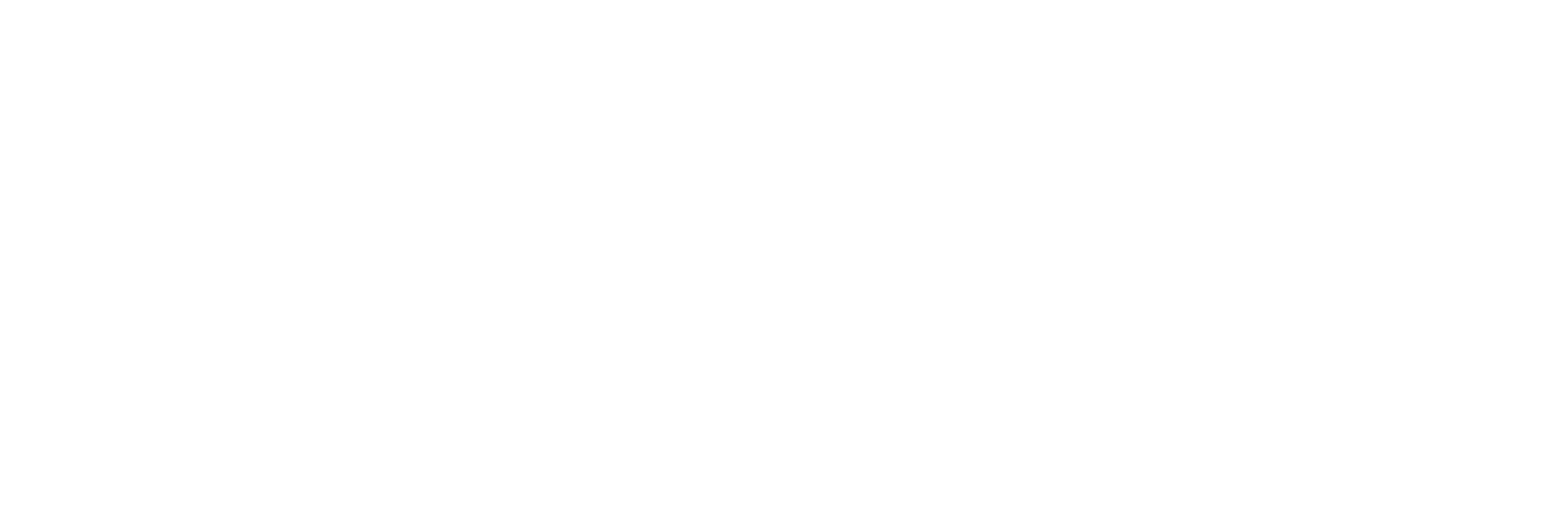Parvathy Ramaswami lors de sa mission en Sierra Leone en 2015 (Photo : Parvathy Ramaswami)
Cette fois, notre conversation avec des négociatrices aux carrières humanitaires exceptionnelles nous a conduits en Afghanistan, où nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec Parvathy Ramaswami, coordinatrice humanitaire par intérim et directrice nationale adjointe du PAM en Afghanistan. La conversation a porté sur la façon dont les compétences linguistiques et culturelles, ainsi qu'une équipe unie, peuvent être un facteur essentiel pour gagner en légitimité face à la contrepartie.
Parvathy a étudié la communication de masse après sa première maîtrise et a commencé sa carrière en tant qu'assistante de recherche en visitant les zones rurales autour de New Delhi et de l'État d'Haryana. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle a travaillé sur quelques projets de l'UNICEF et a voyagé dans différentes régions de l'Inde, un travail qui l'a fascinée. Cette expérience l'a motivée et l'a incitée à poursuivre son travail dans le secteur de l'aide au développement. Lorsque l'occasion s'est présentée de travailler pour une société de conseil du secteur privé qui fournit des conseils en matière de développement à des organisations gouvernementales, non gouvernementales et internationales, elle n'a pas hésité à accepter l'offre.
Rejoindre le PAM était la prochaine étape logique, et c'est ce qu'elle a fait en 1996. Très vite, elle a commencé à travailler sur des interventions en cas de catastrophe et d'autres projets humanitaires dans le monde entier. En août 2019, elle s'est installée en Afghanistan. Aujourd'hui, elle travaille en tant que coordinatrice humanitaire responsable. Cela signifie qu'elle s'occupe désormais des questions d'accès qui concernent l'ensemble de la communauté humanitaire en Afghanistan, et pas seulement le PAM.
L'intérêt de parler une langue locale
Parvathy ne pense pas que le fait d'être une femme lui ait posé des problèmes lors des négociations. Elle estime que le fait de parler la langue locale et d'être consciente de respecter les normes culturelles locales a toujours été un facteur plus important dans les relations avec ses contreparties que son sexe. La seule chose qu'elle a remarquée, c'est que parfois ses contreparties ne la regardent pas dans les yeux. "Mais je n'ai jamais eu l'impression qu'ils ne m'écoutaient pas ou qu'ils ne tenaient pas compte de mes arguments. Je pense qu'ils ont remarqué que j'étais très persistante et tenace puisque je revenais sur le même point toutes les 10 à 15 minutes pendant la négociation. Il était clair pour eux que je n'abandonnais pas", souligne Parvathy.
Elle est convaincue que c'est en étant capable de répondre à toutes les questions que votre contrepartie peut se poser que vous ferez la différence. Et la confiance nécessaire à cette fin repose sur des faits et des preuves. Elle souligne également que le comportement d'un négociateur et le respect qu'il manifeste à l'égard de sa contrepartie sont essentiels. Par exemple, en Afghanistan, il est d'usage, lorsqu'on rencontre des gens dans un espace public, de se couvrir la tête et, lors d'une discussion, de laisser les gens finir de parler.
Une communication transparente lors des négociations, c'est-à-dire une communication qui ne prend pas les gens de haut, est également essentielle. "Inclure la population touchée dans une intervention d'urgence et la consulter sur ses besoins fait une grande différence", affirme Parvathy. Elle veille toujours à expliquer ce qu'est son organisation et son objectif. "Le fait que les gens nous aient vus marcher dans des endroits où l'eau coulait jusqu'aux genoux et dégager les cargaisons du PAM dans les gares lors de la réponse au cyclone en Odisha a permis à la population locale de comprendre notre soutien", ajoute Parvathy.
Plus important encore, elle estime que le fait de parler une langue locale lui a permis d'avoir un meilleur accès aux populations vulnérables. Lorsqu'elle travaillait au Sri Lanka, le fait de parler le tamoul lui a permis de communiquer ouvertement et directement avec les populations concernées. Elle a indiqué que les gens allaient naturellement vers elle et parlaient de leur vie dans un domaine contrôlé par les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE).
Mais c'est au cours d'une négociation avec un couple de hauts dirigeants talibans en Afghanistan qu'elle a réalisé à quel point son bagage linguistique et culturel était précieux. Lorsqu'elle leur a dit qu'elle avait grandi dans le nord de l'Inde, les chefs talibans ont commencé à lui parler en ourdou. "Nous avons parlé de nourriture et de ce que j'aimais en Afghanistan, comme les grenades et les figues, ou les fruits secs, comme les badams (amandes). Pour moi, cette conversation a changé la saveur de l'interaction", explique Parvathy.
D'autre part, le fait de parler une langue locale indique également à sa contrepartie qu'elle garde les yeux et les oreilles ouverts. Cela signifie que son contrepartie pourrait évaluer différemment sa position de pouvoir dans la négociation, ou qu'elle sera plus compréhensive à son égard. Elle estime que l'établissement d'un rapport est très différent lorsque vous conversez dans une langue locale avec votre contrepartie.

Parvathy Ramaswami avec le personnel féminin du PAM en Afghanistan en 2018. (Photo : Parvathy Ramaswami)
Un front uni
D'après l'expérience de Parvathy, la contrepartie tiendra compte de la force de l'équipe en termes de ce qu'elle apporte à la table, c'est-à-dire le contenu, les principes et les lignes rouges. Et pas tellement le fait qu'ils négocient avec une femme.
Toutefois, a-t-elle ajouté, lorsque les équipes sont composées d'hommes et de femmes, mais que les membres de l'équipe n'accordent pas la même valeur aux femmes et aux hommes, l'autre partie peut le remarquer et s'en servir pour saper ce que disent les femmes de l'équipe.
"C'est pourquoi il est très important de clarifier le rôle de chaque membre de l'équipe et de s'appuyer sur les forces de chacun, plutôt que d'entrer en compétition. Il est très important de faire preuve d'unité, de cohésion et d'équité entre les membres de l'équipe", souligne Parvathy.
Faire fructifier l'argent
Le premier mentor de Parvathy a été sa patronne au sein de la société de conseil en développement. Elle lui a beaucoup appris de son expérience pratique au sein de l'Agence danoise de développement international (DANIDA).
Mais elle n'a pas été la seule. Tout au long de sa carrière, Parvathy a rencontré de nombreuses personnes qui lui ont servi de mentors. Il s'agissait de personnes avec lesquelles elle pouvait lancer des idées, qui lui proposaient des options et ne la jugeaient jamais pour ses opinions, mais lui posaient des questions qui l'amenaient à penser différemment.
Parvathy a toujours bénéficié de ce type de soutien et, dans le cadre de son travail avec le PAM, elle s'est efforcée de transmettre ce qu'elle a appris aux jeunes. "Mes mentors m'ont toujours soutenue, m'ont permis d'apprendre, et nous avons toujours été transparents, nous n'avons jamais caché d'informations, qu'elles soient positives ou négatives. Et bien sûr, ils ont toujours pris de mes nouvelles pour savoir comment je me sentais", explique Parvathy.
Garder l'esprit ouvert
"Ce que je considère comme la qualité la plus importante [chez un humanitaire], c'est l'ouverture d'esprit", a déclaré Parvathy. Le conseil qu'elle donne aux jeunes femmes qui débutent dans l'humanitaire et qui sont envoyées pour négocier en première ligne est l'écoute. Pour elle, c'est en étant capable de comprendre des points de vue différents et en ne sautant pas trop vite aux conclusions que l'on devient un bon humanitaire.
Un autre conseil qu'elle a donné est le suivant : "N'ayez pas peur : "N'ayez pas peur. Vos contreparties sont des êtres humains, tout comme vous. Ils peuvent faire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, mais il ne faut pas avoir peur", a expliqué Parvathy.
Dans l'ensemble, Parvathy considère l'aide humanitaire comme un domaine travail très intéressant. Elle sait que cela peut être difficile car il faut souvent improviser et on ne peut pas toujours être préparé. "Il y a beaucoup de nuances et d'émotions humaines. C'est un domaine dans lequel il faut vraiment grandir et découvrir cette facette de soi-même. Les résultats viennent lentement", explique Parvathy.
L'empathie et l'humanité sont essentielles
"Je pense que le manque de diversité vient de la manière dont nous recrutons les gens. Il ne s'agit pas seulement de recruter des personnes diverses, mais aussi d'embaucher des personnes capables d'adopter des points de vue différents", souligne Parvathy. Pour elle, les organisations peuvent remplir les conditions requises en ayant le bon nombre de femmes et d'hommes de diverses nationalités, mais cela ne garantit pas que les personnes seront ouvertes et disposées à accepter des perspectives différentes.
Parvathy estime qu'il est essentiel de prêter attention aux compétences comportementales et d'évaluer les candidats en fonction de ces qualités, ainsi que de leurs compétences techniques.
"Si l'on veut vraiment améliorer la diversité et l'inclusion dans les organisations humanitaires, il faut faire appel à des personnes qui ont de l'empathie et de l'humanité et qui ne se contentent pas de paroles en l'air", a souligné Mme Parvathy.
Parler aux femmes
Enfin, Parvathy a souligné l'importance de parler directement aux femmes touchées par les conflits. Pour pouvoir évaluer réellement les besoins des femmes, il est important d'avoir un accès direct à ces dernières et de ne pas obtenir d'informations de tierces parties.
"Nous devons savoir si les femmes veulent éduquer leurs petites filles, gagner de l'argent ou bénéficier de meilleurs services de santé", explique Parvathy. Pour elle, il est essentiel d'atteindre les femmes, en particulier dans les pays en conflit, afin d'obtenir une meilleure perspective.