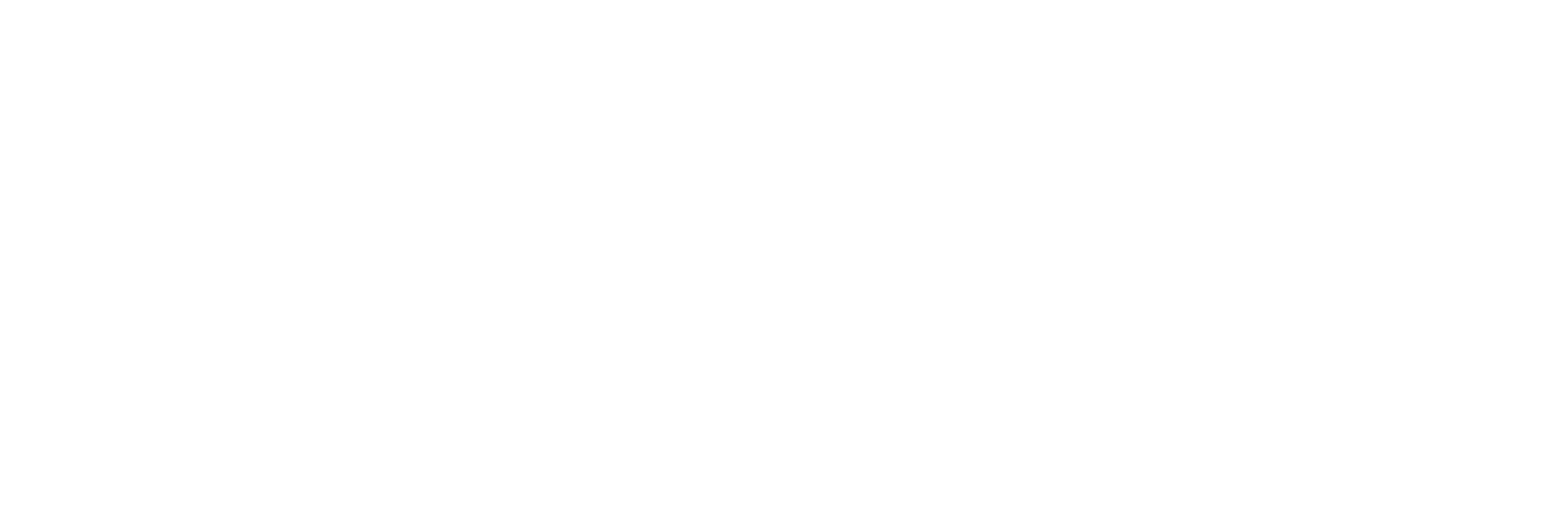Les membres du comité des femmes organisent des sessions de sensibilisation sur COVID-19, la violence liée au sexe et l'orientation sûre dans le camp 24, Cox's Bazar, Bangladesh (Photo : Abdullah Al Mashrif/IOM).
La crise du COVID-19 a d'importantes répercussions sur la protection, la santé et la situation socio-économique des réfugiés rohingyas. Près d'un million de réfugiés rohingyas vivent aux côtés de communautés d'accueil parmi les plus exposées dans le sud du Bangladesh, une région sujette aux catastrophes et déjà vulnérable à un large éventail de chocs et de stress, ainsi qu'à la violence domestique et sexiste.
Effets sexospécifiques et risques de protection au Bangladesh pendant le confinement du COVID-19
Depuis que le confinement a été imposé et que les activités humanitaires essentielles ont été redéfinies fin mars, les acteurs humanitaires s'efforcent de négocier l'accès aux communautés à l'aube de la saison des moussons et des cyclones, ce qui rend l'environnement de protection de plus en plus complexe et multicouche avec des risques croisés liés à la COVID-19. Le COVID-19 a également un certain nombre d'effets sexospécifiques qui affectent de manière disproportionnée les femmes et les filles à risque dans les communautés de réfugiés et d'accueil, ainsi que leur accès à des services de lutte contre la violence sexospécifique qui peuvent leur sauver la vie.
Les mesures nationales de confinement, de restriction des déplacements, de quarantaine, d'isolement et de protection des communautés sont susceptibles d'avoir impact négatif impact tensions au sein des ménages à mesure que la crise se prolonge, restreignant davantage les déplacements des femmes et des filles et leur accès à des services déjà limités, tout en contribuant à l'augmentation des risques de violence entre partenaires intimes et de violence domestique, ainsi que de violence contre les enfants. La réponse au COVID-19 a mis à rude épreuve les capacités du secteur de la santé, ce qui soulève des préoccupations majeures liées à l'interruption des services essentiels et vitaux de santé sexuelle et reproductive et de lutte contre la violence fondée sur le genre. D'autres restrictions à la mobilité des femmes et des jeunes filles ont affecté leur accès aux points de service, faisant du suivi des cas sûrs une activité de plus en plus difficile. En outre, les récentes restrictions gouvernementales ont réduit l'ampleur et la portée des opérations humanitaires autorisées pendant le COVID-19, ce qui a eu un impact sur l'accès aux communautés et sur les voies d'orientation disponibles. Les prestataires de services réduisant leur présence sur le terrain, l'espace humanitaire se rétrécit, ce qui constitue l'un des principaux facteurs de protection pour les communautés touchées.
Négociation d'un accès sûr aux services de lutte contre la violence liée au sexe et adaptation des modalités
La violence liée au sexe reste une préoccupation majeure à Cox's Bazar et la négociation de programmes liés à la violence liée au sexe, qu'il s'agisse de prévention, d'atténuation risques ou de réponse, est un processus continu qui nécessite une approche multidimensionnelle en collaboration avec les autorités gouvernementales locales et les communautés. Trois ans après le début de la réponse humanitaire, les spécialistes de la GBV sont plus familiers avec les négociations sur le terrain qui ont eu beaucoup plus d'adhésion au niveau de la communauté, des services multisectoriels, des voies de référence, des groupes communautaires et des stratégies d'engagement. Négocier des programmes de lutte contre la violence liée au sexe avec les autorités locales au niveau des camps a toujours été un défi et est en constante évolution. Dans le cadre des restrictions actuelles, les spécialistes de la violence liée au sexe ont réussi à négocier certaines composantes du programme comme étant " critiques " pendant la COVID-19, qui sont plus axées sur la réponse, et ont adapté la programmation dans la mesure du possible.
Certains acteurs de la protection ont adapté leurs activités en adoptant des approches à distance telles qu'une ligne d'assistance téléphonique ou des conseils par téléphone. Cependant, pour les spécialistes de la violence liée au sexe, ces modalités peuvent créer de nouveaux risques et sont limitées dans leur portée, car de nombreuses femmes et filles n'ont pas accès à un téléphone en toute sécurité. Il est important de noter que le recours aux lignes téléphoniques d'urgence est précaire, étant donné que les réfugiés rohingyas ne sont pas légalement autorisés à accéder aux cartes SIM locales et que les coupures de télécommunications sont fréquentes dans les camps. Compte tenu de ces difficultés, les acteurs de la lutte contre la violence liée au sexe ont réussi à négocier l'inclusion de certain activités "vitales", notamment en veillant à ce que les services de gestion des cas en personne puissent continuer, généralement dans des points de service situés dans des espaces sûrs pour les femmes et les filles ou dans des établissements de santé. Bien qu'il s'agisse d'une réalisation importante pour le secteur de la violence liée au sexe, compte tenu de l'environnement opérationnel restrictif actuel, des défis persistent. Par exemple, la réduction de 50 % du personnel en raison des restrictions imposées par le gouvernement affecte la qualité des soins et, avec ce nouveau statu quo d'"un assistant social par établissement", les superviseurs s'inquiètent de la qualité des soins, de l'épuisement des assistants sociaux et du manque d'adhésion aux normes minimales interinstitutions en matière de violence liée au sexe dans les situations d'urgence. Les activités de prévention et de sensibilisation à la violence liée au sexe au niveau communautaire ont été mises de côté pour se concentrer sur la sensibilisation à COVID-19.
Les activités de soutien psychosocial et d'apprentissage de la vie destinées aux femmes et aux jeunes filles ont également été maintenues tant qu'elles se concentrent sur le thème de l'enquête COVID-19. Les spécialistes de la violence liée au sexe ont dû faire preuve d'innovation dans leurs approches, car il est essentiel de maintenir des services autres que la gestion des cas dans ces centres afin de garantir qu'ils restent un espace sûr et non stigmatisant pour les femmes et les jeunes filles et qu'ils ne risquent pas de devenir un "centre de lutte contre la violence liée au sexe". Par exemple, les cours de couture, bien qu'interrompus au début du COVID-19, ont pu reprendre tout en respectant les directives de distanciation physique. Les femmes et les adolescentes formées ont pu continuer à développer leurs compétences, cousant désormais des masques pour leurs communautés et leurs familles.

Le service de protection de l'OIM cartographie des risques de violence liée au sexe pendant la saison de la mousson dans le camp 9, à Cox's Bazar, au Bangladesh. (Crédit photo : Rawshan Zannat/IOM)
Malgré quelques avancées récentes, les rumeurs, les craintes et la désinformation liées à COVID-19 continuent d'avoir impact accès aux services et les restrictions croissantes observées dans la circulation des femmes et des filles dans l'espace public entravent le suivi des cas en toute sécurité. Les spécialistes de la violence liée au sexe doivent constamment rappeler que le fait de ne pas établir un rapport ne doit pas être interprété à tort comme une réduction de la violence liée au sexe. Au contraire, l'absence de données de prévalence couplée aux observations des prestataires de services de gestion de cas est déconcertante pour les spécialistes de la VBG sur le terrain et beaucoup d'efforts ont été faits entre les groupes de travail techniques inter-agences pour adapter stratégiquement les interventions, suivre de près les cas de violence entre partenaires intimes et déployer un programme de prévention de la VBG encadré comme une activité " critique " d'atténuation risques dans le cadre de COVID-19.
Préparation aux catastrophes : Une meilleure pratique émergente
En s'appuyant sur les expériences passées et les enseignements tirés de l'atténuation risques de violence liée au sexe et de la réduction des risques de catastrophe, certaines stratégies clés ont été adaptées pour répondre au double défi que représente le COVID-19 pendant la saison des moussons. Le comité des femmes de Teknaf, composé de femmes rohingyas et bangladaises, a servi de modèle de bonne pratique. Formées en tant que premiers intervenants, elles ont joué un rôle clé l'année dernière en veillant à ce que les ménages et les individus les plus à risque soient inclus dans les mécanismes d'alerte précoce et de réponse et en élaborant des plans d'évacuation des ménages nécessitant une assistance spécialisée pour les personnes ayant des problèmes de mobilité, ainsi qu'une orientation sûre des cas de protection et de violence liée au sexe. Les équipes de l'OIM chargées de la lutte contre la violence liée au sexe considèrent le COVID-19 comme un risque similaire aux chocs et stress plus familiers tels que les inondations, les glissements de terrain et les cyclones, afin d'élaborer des plans de préparation des ménages et prévoient de réaffecter les structures communautaires existantes et les groupes communautaires qualifiés pour soutenir ces efforts. Il est essentiel de travailler avec les communautés compte tenu des nombreuses préoccupations des individus et des communautés (par exemple, que faire si quelqu'un est mis en quarantaine, être séparé de ses proches dans un contexte de tensions, de rumeurs et de craintes croissantes). L'intégration du COVID-19 en tant qu'"autre risque à prévoir" peut constituer une approche plus holistique et pratique pour interagir individus et les communautés et maintenir une forte perspective de protection et de VBG dans la cartographie des risques et la planification de l'action.
Les spécialistes de la violence liée au sexe se préparent également à de nouvelles restrictions d'accès en s'alignant stratégiquement sur les équipes de santé. Par exemple, le modèle des équipes mobiles d'intervention médicale, activées généralement au début immédiat d'une catastrophe, a intégré des points focaux sur la violence liée au sexe et recevra une formation supplémentaire à la lumière de l'enquête COVID-19. Ces points focaux travailleront désormais dans des installations de quarantaine et des centres d'isolement et de traitement (ITC) récemment construits et dotés de salles de conseil dédiées à la protection.
Difficultés à fournir des services de lutte contre la violence liée au sexe dans le cadre de la riposte au COVID-19
Il est essentiel que les gouvernements, les partenaires et les donateurs partent du principe que la violence liée au sexe est présente dans toutes les crises et qu'il n'est pas nécessaire de disposer de données de prévalence fiables sur l'ampleur de la violence liée au sexe pour concevoir des interventions appropriées. Les données sur la violence liée au sexe sont et seront toujours difficiles à obtenir, en raison de l'insécurité, des lacunes dans les services, du manque de protection des survivants, de la peur des représailles et de l'impunité des auteurs, de la stigmatisation sociale, des perceptions et des normes culturelles relatives à la violence sexuelle et de la pression exercée par la communauté sur les survivants. Les services de lutte contre la violence liée au sexe permettent de sauver des vies et doivent être considérés comme un élément tout aussi essentiel de la réponse au COVID-19. Cela dit, ces services ne doivent pas se concentrer uniquement sur la "réponse" ou le soutien aux survivants, mais également sur un large éventail d'activités complémentaires d'atténuation risques et de prévention, qui devront être adaptées à la lumière des mesures de prévention de COVID-19, mais qui ne peuvent pas s'arrêter complètement.
Les négociations au niveau national sont aujourd'hui plus impératives que jamais pour garantir l'accès et maintenir un environnement protecteur pour les communautés touchées, dans un contexte de risques en constante évolution, tels que l'augmentation de la violence, des abus et de l'exploitation, la traite des êtres humains, la protection des enfants et la violence fondée sur le sexe.
A propos de l'auteur

Megan Denise Smith est membre de la communauté de pratiqueCCHN et travaille avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Cox's Bazar, au Bangladesh, en tant que responsable de la lutte contre la violence sexiste.