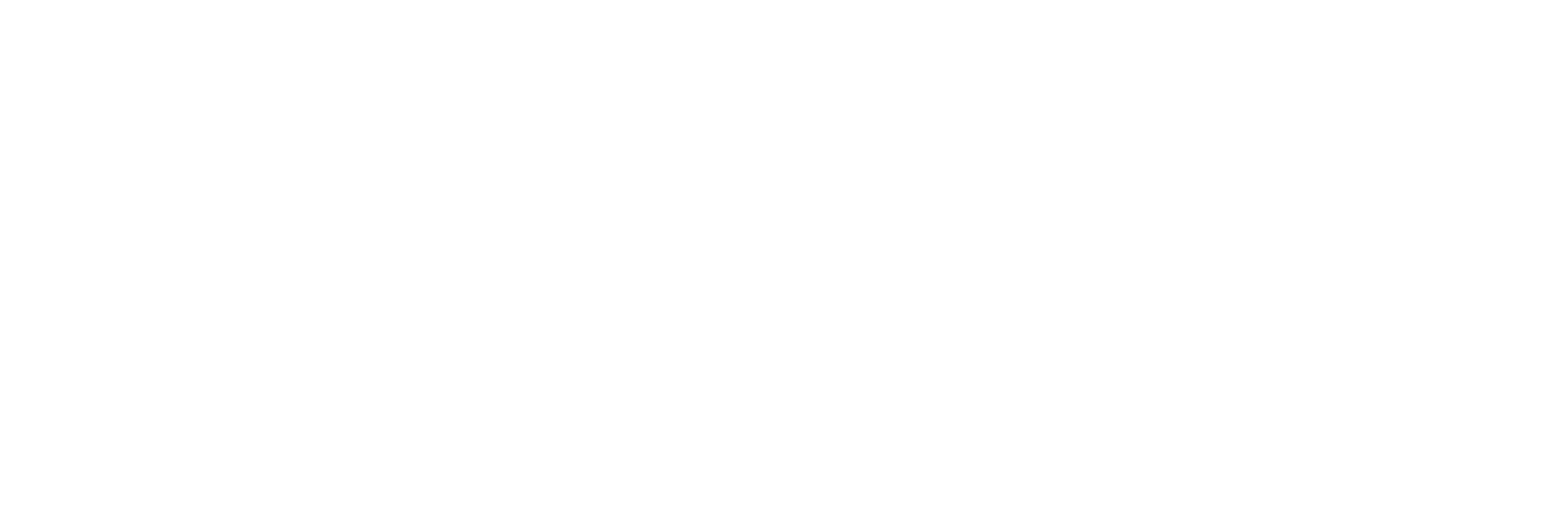Somalie, Bakool. Novembre 2008, deux femmes discutent de la situation concernant la nourriture apportée par le PAM sous le regard d'un membre de l'équipe de sécurité. (Photo : PAM/Guled Mohamed)
Le Centre de Compétence en Négociation HumanitaireCCHN s'efforce continuellement de rechercher des sujets de négociation qui intéressent les membres de sa communauté. En février 2021, Hanalia Ferhan et Marcia Vargas, spécialistes de l'appui aux négociations pour l'Afrique et l'Amérique latine respectivement, ont organisé un échange échange entre membres de la communauté du CCHN sur la négociation avec les groupes criminels. Ce mélange de contextes africains et latino-américains a permis aux membres de la communauté des deux régions d'échanger les leçons apprises et les bonnes pratiques dans la conduite de négociations avec des contreparties qualifiées de "criminelles".
Alors que les discussions régulières du CCHNsur les négociations humanitaires impliquent généralement les autorités locales ou les groupes idéologiques comme contreparties, les membres de notre communauté de pratique se retrouvent également engagés avec un autre type d'acteur, à savoir les groupes criminels. La pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation des interactions entre les groupes criminels et les agences humanitaires. En Colombie, par exemple, la présence réduite de l'État dans certaines régions a permis aux groupes criminels de renforcer leur emprise. Au Nigeria, la pandémie a incité les organisations humanitaires à apporter une aide aux populations dans les zones contrôlées par les groupes criminels, en particulier dans les zones urbaines. Au cours de l'échange échange entre membres de la communauté du CCHN , des membres de la communauté issus de différentes réalités d'Afrique et d'Amérique latine ont échangé leurs expériences sur les particularités des négociations avec les groupes criminels et les environnements dans lesquels ils opèrent. Ils ont partagé leurs points de vue et leurs idées sur les différents défis et dilemmes rencontrés et sur les bonnes pratiques mises en place.
Définition des groupes criminels
Au cours de la discussion, plusieurs similitudes ont été identifiées lorsqu'il s'agit de négocier avec ce que l'on appelle vaguement les "groupes criminels" et d'autres acteurs politiques ou militants actifs dans des endroits où il y a un vide de gouvernance. Cependant, la motivation des "groupes criminels" est une caractéristique clé qui les distingue. Alors que de nombreuses contreparties avec lesquelles les praticiens humanitaires interagir habituellement sont motivées par une idéologie (généralement politique ou religieuse), les groupes criminels sont principalement motivés par des gains financiers ou matériels. En Colombie, par exemple, les groupes criminels sont impliqués dans un large éventail d'activités, telles que la production de drogue, l'immigration illégale et l'extorsion, principalement pour leur propre bénéfice financier. Au Nigeria, les organisations humanitaires qui travaillent dans les zones urbaines, y compris les bidonvilles, doivent négocier l'accès avec des confréries impliquées dans la destruction de biens, les enlèvements et les pillages, ainsi qu'avec des groupes armés de voyous qui se livrent au vol et à la petite délinquance.
"Lors d'une distribution, un groupe criminel faisant partie de la communauté a attaqué l'organisation humanitaire. L'intérêt principal du groupe était de revendre le matériel à des fins lucratives".
Identifier et comprendre les groupes criminels en tant que contreparties
La première série de défis abordés consiste à comprendre qui sont les groupes criminels qui exercent leur autorité sur un territoire donné. Les dynamiques de conflit volatiles dans les régions anglophones du Cameroun, par exemple, signifient que les zones peuvent changer de mains tous les jours, parfois avec l'apparition de nouveaux groupes. Par conséquent, les praticiens de l'aide humanitaire doivent continuellement adapter leur analyse de la situation et leur cartographie des groupes qui y opèrent.
Et même lorsque les différents groupes ont été identifiés, il peut être défi de déterminer à qui s'adresser au sein de ces groupes. Dans certains contextes, la faiblesse des structures organisationnelles et la fluide chaînes de commandement au sein des groupes criminels font qu'il est difficile de déterminer qui est la personne la plus autorisée ou la plus représentative sur une question spécifique. Il est donc difficile pour les praticiens de l'aide humanitaire de se faire une idée précise des positions des groupes et de comprendre les raisons et les motivations de leurs actions. Pour compliquer encore les choses, les groupes peuvent évoluer au fil du temps, tant au niveau de leurs motivations que de leurs intérêts, développant souvent des agendas de plus en plus politiques. Il est donc encore plus difficile de les définir et de les comprendre. En République centrafricaine (RCA), par exemple, les anti-balaka sont des groupes d'autodéfense qui ne sont pas bien organisés, et les praticiens de l'aide humanitaire peuvent donc avoir du mal à les identifier. Alors qu'ils n'avaient pas de motivations politiques à l'origine, ils sont de plus en plus motivés par des agendas politiques et l'ambition d'obtenir des résultats politiques.
"Ce qu'il faut faire, c'est établir une conversation avec les groupes criminels pour comprendre leurs motivations.
Exploiter les relations avec les autres acteurs de l'écosystème des groupes criminels
Les praticiens qui ont participé à la discussion ont identifié d'autres acteurs clés à prendre en considération lors de la négociation de l'accès avec les groupes criminels. Avant tout, ces groupes sont souvent ancrés dans les communautés locales (bien que le degré d'intégration dépende du contexte, bien entendu). Dans certaines régions du Cameroun, par exemple, les "entrepreneurs de guerre" viendraient du Nigeria voisin et établiraient des relations de travail avec la population locale - une pratique qui a également été signalée en Colombie. En RCA, où les anti-balaka ont également des liens avec les communautés, il a été souligné qu'ils sont prompts à abuser de leur pouvoir et à profiter de leur position dominante sur les habitants.
"Les criminels connaissent la communauté et la communauté connaît les criminels.
Il est donc important pour les négociateurs de déterminer si et dans quelle mesure les positions des groupes criminels représentent celles des communautés plus larges au sein desquelles ils opèrent, et pour cela une cartographie de la partie prenante est utile. La capacité d'une organisation à tirer parti de sa légitimité et de son acceptation au sein des communautés peut être déterminante pour sa capacité à recueillir ou à confirmer des informations de qualité. Il s'agit également d'un moyen essentiel d'atténuer les risques en matière de sécurité, qui peuvent être plus importants lorsque l'aide est apportée dans les zones urbaines, y compris les bidonvilles, que dans les points de distribution statique .
Les autorités locales ont également été présentées comme des figures clés à prendre en compte dans toute partie prenante de la cartographie et de l'analyse du contexte en ce qui concerne les groupes criminels, même si ces groupes ont tendance à prospérer dans un vide de gouvernance. Les praticiens ont souligné le dilemme qui se pose lorsque les contraintes imposées par les autorités entrent en conflit avec les normes professionnelles. Ainsi, en Colombie, le cadre de legitimité fait qu'il est difficile, voire illégal, pour les organisations d'interagir avec les groupes criminels en fonction de leur mandat. Dans ce contexte et dans d'autres, comme les pays du Triangle du Nord en Amérique centrale, il a été souligné que les négociateurs humanitaires ont recours à des relais communautaires pour établir le contact avec les groupes criminels.
En outre, les praticiens de terrain doivent négocier avec des services répressifs qui n'interagir pas avec les groupes criminels eux-mêmes (que ce soit par manque de capacité, de mandat ou de volonté). Les négociateurs et leurs organisations sont donc soumis à une pression accrue et il leur est plus difficile d'établir la confiance avec les deux types de contreparties. D'une part, les forces de l'ordre peuvent considérer que les organisations humanitaires offrent une légitimité aux groupes criminels. D'autre part, les membres des groupes criminels peuvent être réticents à faire confiance aux organisations humanitaires qui opèrent dans un système institutionnel et de legitimité qui les discrimine en raison de leur appartenance à un groupe.
Clarifier les intérêts, les priorités et les objectifs des organisations humanitaires
Pour instaurer la confiance au sein des groupes criminels, les négociateurs humanitaires ont expliqué qu'il est possible, dans certains contextes, d'identifier les membres des groupes qui répondent aux critères de ciblage des organisations humanitaires. En les incluant dans les listes de bénéficiaires, ils peuvent montrer comment les principes humanitaires d'humanité et d'impartialité fonctionnent dans la pratique, démontrant ainsi qu'ils sont dignes de confiance et augmentant leurs chances d'obtenir l'accès. Certains participants ont également décrit comment ils ont parfois pu compter sur des groupes criminels pour certain aspects de leurs opérations, tels que le contrôle des foules, de la même manière qu'ils utiliseraient des institutions communautaires informelles locales dans d'autres circonstances. Ces considérations sont étroitement liées à la capacité des négociateurs à s'appuyer sur des lignes rouges clairement définies par leurs mandataires.
Enfin, l'échange entre membres de la communauté du CCHN a permis d'approfondir le dilemme clé de la négociation avec les groupes criminels, à savoir la nécessité d'interagir avec eux pour garantir un accès direct aux personnes dans le besoin et atténuer risques de sécurité sans les légitimer.
Pistes de réflexion et prochaines étapes
Plusieurs des outils proposés par le CCHN semblent utiles aux praticiens de l'humanitaire lorsqu'ils planifient des négociations avec des groupes criminels. Toutefois, un certain nombre de défis et de dilemmes spécifiques importants subsistent.
Si vous êtes un praticien de terrain qui mène des négociations avec des groupes criminels, vous avez peut-être été confronté à des problèmes similaires. Ou peut-être votre expérience et votre pratique sont-elles différentes. N'hésitez pas à partager et à approfondir le processus de réflexion que nous avons entamé avec les participants à cet échange entre membres de la communauté du CCHN.
Si vous n'êtes pas un professionnel de l'humanitaire mais que vous êtes impliqué dans la communauté du CCHN , nous aimerions également lire vos réflexions et vos expériences qui pourraient être pertinentes pour la négociation avec les groupes criminels.